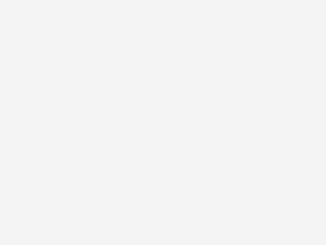
Accompagner une mère qui présente des douleurs aux mamelons
Laurence Villedieu, sage-femme libérale, Paris, titulaire du diplôme interuniversitaire de lactation humaine et allaitement maternel (DIU LHAM) et formatrice Co-naître®. L’article est issu de la retranscription d’une intervention orale au Congrès national de la sage-femme libérale de 2020. L’autrice déclare n’avoir aucun lien avec des entreprises ou établissements produisant ou exploitant des produits de santé. Elle ne déclare aucun conflit d’intérêts susceptible d’influencer son propos sur le thème de l’allaitement. Les douleurs aux mamelons (DAM) représentent 36 % des motifs de consultations postnatales [1]. La fréquence de survenue de douleurs survient dans 79 % des cas avant la sortie de la maternité et persisterait dans 20 % des cas à 8 semaines [2]. De plus, ces douleurs peuvent aussi concerner les mères qui tirent leur lait. Dans la population générale, les croyances sont nombreuses : certains pensent qu’il faut préparer les bouts de seins pendant la grossesse, qu’utiliser des protèges mamelons en silicones empêche d’avoir mal ou que si les douleurs persistent c’est qu’il y a un frein de langue ou une candidose. Lorsqu’une mère présente des DAM, elle cherche des solutions sur internet et les réseaux sociaux et passe de professionnel en professionnel à la recherche d’une solution. Pourtant cette situation est très souvent évitable : elle résulte dans la plupart des cas d’une conduite inappropriée de l’allaitement maternel, comme un simple problème de position. Pour preuve, 58 % des douleurs s’améliorent avec une position efficace [1]. Nous aborderons ce sujet dans une approche respectant la philosophie de soins centrés sur l’enfant et sa famille. I. Les DAM et leurs conséquences Les premières questions que se posent les femmes sont « Est-ce normal d’avoir mal quand on allaite ? Combien de temps ? ». En raison de l’imprégnation œstrogénique, la sensation douloureuse aux mamelons est tout à fait physiologique en début de tétée et pendant les dix premiers jours de […]


