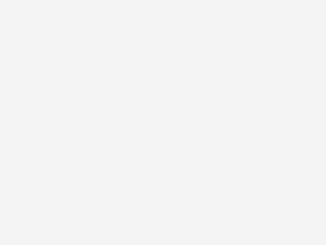
« Les sages-femmes ont un vrai rôle à jouer »
Pensez-vous que les sages-femmes puissent dépister des jeunes filles en situation de prostitution ? Les sages-femmes ont un rôle dans l’accompagnement des jeunes, autour de la contraception, de la gynécologie, de l’orthogénie, y compris dans l’accompagnement des grossesses de jeunes ou de très jeunes femmes qui ne vont pas forcément très bien. C’est important qu’elles s’autorisent à poser des questions. Elles le font déjà pour les violences sexuelles ou la consommation d’alcool. Par ailleurs, ces professionnelles ont un contact avec le corps qui est sans doute plus facile, par rapport à d’autres soignants. En outre, elles s’occupent beaucoup plus du corps sexuel. Elles peuvent sans souci aborder la notion de la vie sexuelle. Il faut évidemment qu’elles soient un peu formées en sexologie et surtout qu’elles restent très bienveillantes avec tous ces publics un peu vulnérables. Ces jeunes filles en situation de prostitution ne sont pas toujours très observantes, avec les conseils comme avec les traitements. Mais presque toutes les sages-femmes, quel que soit leur mode d’exercice, peuvent repérer, dépister. Elles ont un vrai rôle à jouer. Cela sous-entend qu’il faut être capable d’apporter une réponse à la question posée. Pour cela, il faut se construire un réseau. C’est l’une des premières démarches à faire. Dans un premier temps, on peut se tourner vers les associations reconnues comme l’ACPE (Agir contre la prostitution des enfants), qui intervient sur le territoire national et prend en charge les jeunes jusqu’à 21 ans. Pour les plus âgées, on peut solliciter l’Amicale du Nid, qui s’est spécialisée dans les dispositifs d’accompagnement de sortie de la prostitution. Quels signaux doivent alerter ? Il va souvent y avoir une chute du travail scolaire. Les fugues à répétition, les IVG et les IST à répétition, les grossesses précoces, vers 14 ou 15 ans, doivent alerter. Les fugues commencent progressivement puis s’accélèrent. […]




