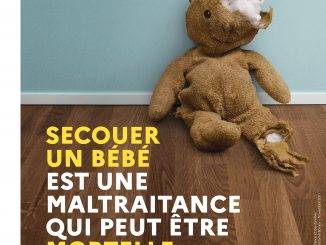En 2018, une étude américaine est venue questionner nos certitudes. Celle-ci a comparé deux populations de femmes nullipares à bas risque. Les patientes du premier groupe ont accepté d’être déclenchées entre 39 SA et 39 SA + 4 j alors que les patientes de l’autre groupe ont été invitées à adopter une attitude expectative, attendant la survenue spontanée du travail jusqu’à 42 SA. Les résultats montrent que le taux de césarienne est significativement plus élevé dans le second groupe. Il en est de même pour la nécessité d’une assistance ventilatoire néonatale dans les 72 premières heures de vie [1].
Cette étude mérite d’être confirmée ou nuancée par d’autres, en s’attachant notamment à évaluer le déclenchement de convenance auprès de populations européennes. Un essai français randomisé multicentrique intitulé French Arrive est en cours à ce sujet.
Cependant, de tels résultats interrogent dès à présent nos pratiques quotidiennes en salle de naissance. Certains services proposent déjà aux patientes éligibles un déclenchement de convenance.
Dans ces situations, les sages-femmes sont en première ligne. De quelle manière sont-elles susceptibles d’engager leur responsabilité lors d’un déclenchement de convenance ?
Pour répondre à cette question, nous procéderons dans un premier temps à un bref rappel sur la notion de responsabilité en droit français. Puis nous étudierons le cas où la sage-femme procède au déclenchement de convenance sur prescription médicale en le comparant, dans un second temps, au déclenchement de convenance que la sage-femme pourrait proposer de sa propre initiative.
I – Rappels sur la notion de responsabilité.
La responsabilité peut se définir comme « l’obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu’elle doit assumer et d’en supporter toutes les conséquences » [2].
Cela signifie qu’elle est appréciée pour chaque personne selon les fonctions qui lui sont attribuées. Au vu des compétences de la personne concernée, il s’agira de définir si celle-ci a réalisé correctement ses missions et, dans le cas contraire, comment elle doit répondre de ses manquements. En d’autres termes, on n’engagera pas la responsabilité de la même façon s’il s’agit d’un quidam qui aide de son mieux une femme sur le point d’accoucher dans un lieu public ou d’une sage-femme qui réalise un accouchement en milieu hospitalier.
On peut distinguer, de façon simplifiée, trois grands types de responsabilités.
A – La responsabilité civile
La responsabilité civile est celle qui va être engagée le plus souvent, lors d’un préjudice subi suite à la réalisation d’actes de soin ou de
prévention ou suite à l’administration d’un traitement. Elle sera engagée si trois conditions sont réunies.
En premier lieu, la sage-femme doit avoir commis une faute qui sera caractérisée par un manquement aux obligations qui lui incombent, telles qu’elles sont inscrites dans le Code Civil ou dans le Code de Santé Publique. Il peut s’agir d’une faute dite « de science » caractérisée par un défaut de soins consciencieux et conformes aux données de la science ou une faute d’ordre technique. Mais il peut également s’agir d’une faute dite « de conscience » telle que le défaut d’information, de recueil du consentement ou le non-respect de la dignité de la personne humaine.
En deuxième lieu, cette erreur doit avoir entraîné un préjudice matériel, moral et/ou physique.
Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
Si la responsabilité est engagée, la sage-femme devra verser des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi. Les sommes seront supportées par son assurance en responsabilité civile professionnelle ou par celle de son établissement.
Le délai d’engagement de cette responsabilité prend fin dix ans après la consolidation du dommage. Les patients ont donc un délai d’action relativement long pour demander réparation de leurs dommages.
B – La responsabilité pénale
La responsabilité pénale sanctionne une infraction au Code pénal. En droit médical, les infractions les plus souvent retenues par les juges sont les coups et blessures involontaires, la mise en danger de la vie d’autrui, la non-assistance à personne en péril, voire, dans les cas les plus graves, l’homicide involontaire. La violation du secret professionnel et l’exercice illégal de la profession sont également punis par des sanctions pénales.
Ces infractions sont, pour la quasi-majorité, des délits qui seront jugés devant le tribunal correctionnel.
Pour que la responsabilité soit engagée, il est nécessaire d’apporter la preuve de l’intention de nuire ou de la violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.
Dans ce cas, la sanction prononcée peut être une peine d’amende, voire d’emprisonnement que les assurances ne prendront pas en charge. La responsabilité pénale est individuelle.
Heureusement, le caractère délibéré de l’acte est souvent absent lorsqu’il s’agit d’actes de soin et la responsabilité pénale est très rarement engagée lorsque des soignants sont mis en cause devant la justice.
Le délai d’engagement de la responsabilité pénale est plus court que pour la responsabilité civile. En effet, en ce qui concerne les délits, il est de six ans à partir de la date de commission de l’acte répréhensible.
C- La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire sera quant à elle engagée en cas de manquement aux obligations déontologiques, qu’elles concernent les relations entre membres de la profession ou les devoirs qui incombent aux sages-femmes vis-à-vis de leurs patientes. Si la violation du Code de déontologie est retenue par la chambre de première instance du conseil de l’Ordre, la sage-femme encourt différents types de sanctions disciplinaires, dont le degré de sévérité varie : recommandations, avertissement, blâme, interdiction d’exercer, qu’elle soit totale ou partielle, définitive ou temporaire, avec ou sans sursis.
Ces trois types de responsabilités pourraient être engagés dans le cadre du déclenchement de convenance. Mais il convient de tenir compte de la « double casquette » des sages-femmes dans la situation de convenance. En effet, les conséquences juridiques ne seront pas les mêmes si elles agissent sur prescription ou de leur propre initiative.
II – Le déclenchement de convenance sur prescription médicale.
A – De quelles situations parle-t-on ?
Dans certaines situations, les sages-femmes pourront être amenées à participer au déclenchement de convenance sur prescription d’un gynécologue-obstétricien. Ce sera notamment le cas si le déclenchement nécessite la pose d’un dispositif intravaginal de diffusion de prostaglandines, la pose d’un ballonnet intracervical ou l’administration de prostaglandines par voie orale, actuellement à l’étude dans certaines maternités. En effet, notre profession n’a pas la prérogative de prescrire ces méthodes [3].
Dans ces circonstances, la sage-femme aura donc principalement un rôle d’information et risquera surtout d’engager sa responsabilité civile.
B – Le devoir d’information
Le devoir d’information incombe aux sages-femmes comme aux autres professionnels de santé. Il est le préalable indispensable afin que la patiente puisse consentir aux soins qui lui sont proposés en toute connaissance de cause. Le Code de la santé publique et le Code de déontologie sont sans équivoque à ce sujet [4]. Ce devoir d’information est intimement lié au respect de l’intégrité de la personne et au recueil du consentement.
Article L1111-2 al. 1 – Code de la santé publique
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. […]
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Article L1111-4 – Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
Article R.4127-327 – Code de la santé publique
Code de déontologie
La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
En 2012, la Haute Autorité de santé a formulé des recommandations précises à ce sujet et a mentionné expressément que les informations devaient être transmises par chacun des acteurs de la chaine de soin, selon son domaine de compétences, sans présumer que l’information a déjà été délivrée par d’autres [5].
Les textes législatifs comme les recommandations des autorités sanitaires détaillent également les éléments qui doivent être expliqués aux patients.
Ceux-ci se doivent d’être clairs, loyaux et appropriés. Si l’on applique ces recommandations au déclenchement de convenance, il conviendra d’indiquer a minima les éléments suivants à la parturiente :
– les différentes méthodes de déclenchement possibles,
– la méthode retenue et pourquoi,
– les avantages escomptés pour la patiente,
– les risques possibles en cas de déclenchement,
– la possibilité de ne pas déclencher et les conséquences s’il y en a.
Le respect du droit à l’information passe donc par la transmission de messages synthétiques, non confus, adaptés aux besoins et aux questions de la patiente.
Les sages-femmes disposent de plusieurs temps au cours desquels l’information peut être délivrée : consultation, séances de préparation à la naissance et à la parentalité, surveillance dans les services d’explorations fonctionnelles, suivi en salle de naissance.
En cas de litiges, elles devront apporter la preuve que les informations ont bien été délivrées. Il est donc important d’accorder le temps et le climat de bienveillance nécessaires à la transmission de l’information et à en faire mention dans le dossier de soin. L’appel à un traducteur peut être nécessaire. La HAS considère que la remise d’une notice d’information, même contre signature, vient seulement compléter la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée, sans pour autant la remplacer. Le Collège national des gynécologues-obstétriciens de France a d’ailleurs émis un modèle de fiche d’information écrite qui peut être utilisé [annexe 1].
C – Les risques encourus
Si la patiente considère que la sage-femme a manqué à son devoir d’information ou n’a pas recueilli son consentement, elle pourra saisir le juge civil et demander réparation du dommage qu’elle considère avoir subi.
Le préjudice est principalement moral. Il est constitué par la perte de chance d’avoir pris une autre décision si la patiente avait eu connaissance de tous les éléments nécessaires ainsi que de l’impréparation qui fut la sienne du fait du manque d’informations sur les soins qui allaient lui être dispensés [6].
La sage-femme pourra également voir sa responsabilité disciplinaire engagée pour le même motif si le conseil de l’Ordre est saisi de la plainte. On peut imaginer que, dans le cas du seul défaut d’information et/ou de recueil du consentement, la sage-femme s’expose plus probablement à un avertissement ou à un blâme qu’à une mesure d’interdiction d’exercer.
Dans cette première situation, la sage-femme pourra également engager sa responsabilité civile, pénale et/ou disciplinaire lors de la pose du dispositif et de la surveillance du déclenchement. Mais cela ne diffère pas des mises en cause qu’elle encourt déjà actuellement lorsqu’elle participe sur prescription au déclenchement du travail, quel qu’en soit le motif.
Il semble donc que la responsabilité des sages-femmes en cas de participation à un déclenchement de convenance sur prescription soit limitée au domaine civil. Il en sera d’une autre façon si la sage-femme propose et réalise ce déclenchement.
III – Le déclenchement de convenance à l’initiative de la sage-femme.
A – De quelles situations parle-t-on ?
Comme le rappelle le Code de déontologie de notre profession, les sages-femmes sont responsables du suivi des grossesses physiologiques et doivent faire appel au médecin en cas de pathologie.
Article R.4127-318 – Code de la santé publique
Code de déontologie
Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L.4151-1 :
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie.
Le déclenchement pour convenance personnelle, en l’absence de toute pathologie maternelle ou fœtale, semble donc pouvoir relever de leur champ de compétences, pourvu qu’il soit effectué selon des méthodes que les sages-femmes sont autorisées à utiliser. Il s’agit du décollement du pôle inférieur de l’œuf (plus couramment appelé décollement des membranes), de l’amniotomie ou de l’administration d’oxytocine [3].
Dans ce cas, l’étendue de la responsabilité de la sage-femme est plus large.
En premier lieu, il est indispensable de rappeler que le devoir d’information reste de mise si la sage-femme est prescriptrice. Dans ce cas, elle est même en première ligne pour renseigner la patiente sur les modalités du déclenchement, les raisons et les risques de celui-ci. À cette obligation s’ajoute nécessairement celle du recueil du consentement de la patiente.
En ce qui concerne ces obligations, elle est donc soumise au même risque d’engagement de sa responsabilité civile que celui vu dans la partie précédente.
Mais le fait qu’elle soit également prescriptrice de l’acte la place face à d’autres risques d’engagement de sa responsabilité.
B – Assurer des soins conformes aux données scientifiques du moment
Les textes obligent les sages-femmes à proposer des soins dont l’efficacité est validée scientifiquement et dont le bénéfice est supérieur aux risques encourus [7].
Le droit de recevoir des soins conformes aux données acquises de la science a été réaffirmé et actualisé par la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.
Cet impératif est d’ordre législatif et s’impose à tout personnel soignant.
Article L1110-5 – Code de la santé publique
Toute personne a, compte tenu de son état de santé […] le droit de recevoir […] les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Le Code de déontologie reprend et précise cette obligation en insistant, dans deux articles distincts, sur la double nécessité qu’elle recouvre : assurer des soins conformes aux données scientifiques et ne pas faire courir de risques injustifiés aux patientes et à leur nouveau-né.
Article R.4127-325 – Code de la santé publique
Code de déontologie
Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Article R.4127-314 – Code de la santé publique
Code de déontologie
La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
Les textes utilisent donc alternativement les termes de « thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue », de « connaissances médicales avérées » ou de « données scientifiques du moment ». Les juges, quant à eux, font parfois référence aux « données acquises de la science », aux « données actuelles de la science », aux « règles de l’art » ou à « l’art en vigueur ».
Mais de quoi parle-t-on précisément ? Quelles sont les sources auxquelles les sages-femmes doivent se référer ?
Dans plusieurs arrêts, la jurisprudence est venue répondre à ces questions.
Les données sur lesquelles les sages-femmes doivent s’appuyer pour exercer leur art avec toute la compétence requise sont issues des manuels et traités, des articles scientifiques, des conférences de consensus et anciennes références médicales opposables ainsi que des recommandations des autorités sanitaires et des experts.
Les données s’entendent à la date des soins [8]. Elles peuvent être issues de sources nationales ou internationales [9]. La jurisprudence précise qu’il n’est possible de s’en écarter que de manière justifiée et adaptée à la personne [10], garantissant ainsi le respect du droit de prescription.
Il est donc impératif que la sage-femme qui prescrit un déclenchement de convenance le fasse en fonction des recommandations scientifiques les plus récentes et les plus fiables.
Actuellement, la HAS recommande de ne proposer le déclenchement de convenance que dans les situations suivantes :
– utérus non cicatriciel,
– terme précis,
– à partir de 39 SA + 0 jour (273 jours),
– col favorable : score de Bishop ≥ 7,
– demande ou accord de la patiente, et information des modalités et des risques potentiels.
La HAS précise également les modalités de décision concernant le mode de déclenchement et la surveillance de la parturiente dans ces situations [11].
C – Les risques encourus
Devant les juridictions civiles
Concernant la responsabilité civile, la sage-femme pourrait engager sa responsabilité si elle prescrivait et réalisait un déclenchement de convenance dans des conditions non conformes aux données de la science. Il s’agirait d’une faute « de science », comme nous l’avons évoqué en première partie. Ce pourrait être le cas si, par exemple, le terme de la grossesse était incertain ou inférieur à 39 SA, ou si l’utérus était cicatriciel.
Si la patiente considérait avoir subi un préjudice du fait de ce déclenchement (césarienne, rupture utérine, hypoxie fœtale assortie de séquelles néonatales, par exemple), elle pourrait exiger la réparation de son préjudice devant les juridictions civiles. L’assurance de la sage-femme ou de l’établissement pour lequel elle travaille serait alors tenue de verser des dommages et intérêts à la patiente s’il était avéré que le déclenchement avait entraîné le préjudice dont la patiente se plaint.
C’est en ce sens que la chambre civile de la Cour de cassation a statué le 17 décembre 2009. Dans cette affaire, une sage-femme avait déclenché le travail d’une patiente, au terme de 38 SA, alors « qu’aucune raison médicale ne justifiait ce déclenchement ». L’accouchement avait eu lieu par voie basse instrumentale, laissant l’enfant porteur de lourdes séquelles. La Cour confirme la condamnation de la clinique pour laquelle travaillait la sage-femme à verser aux parents des dommages et intérêts en précisant que « la décision d’accouchement avait entraîné pour Mme X… la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».
Un déclenchement inapproprié, se soldant par des conséquences néfastes, représente donc aux yeux du juge civil une perte de chance qui mérite indemnisation.
Devant les juridictions pénales
Dans cette situation, et contrairement au déclenchement dans lequel elle n’est pas prescriptrice, la sage-femme pourrait également engager sa responsabilité pénale. En effet, le fait de prescrire un déclenchement sans respecter les recommandations en vigueur pourrait être assimilé à un manquement délibéré à une obligation de sécurité exposant autrui à un risque d’une particulière gravité. Les dommages causés à la patiente et/ou au nouveau-né pourraient alors être qualifiés de coups et blessures involontaires. Dans ce cas, les peines encourues sont des peines d’amende, qu’aucune assurance ne prendra en charge, voire, très exceptionnellement, des peines d’emprisonnement.
Devant les instances disciplinaires
Enfin, si l’affaire est portée devant les instances disciplinaires, le conseil de l’Ordre pourrait être amené à prononcer des sanctions à l’encontre de la sage-femme en raison du non-respect des règles déontologiques citées plus haut. Celles-ci pourraient aller jusqu’à une interdiction d’exercer, temporaire ou définitive, concernant tout ou partie des fonctions de la sage-femme concernée.
Conclusion
Le déclenchement de convenance est une pratique que les sages-femmes rencontrent régulièrement, de près ou de loin, en respectant une prescription faite par un gynécologue-obstétricien ou en le prescrivant elles-mêmes.
Nous venons de le voir, les modalités d’engagement de la responsabilité des sages-femmes diffèrent selon qu’elles agissent sur prescription ou de leur propre initiative.
Dans le premier cas, elles seront principalement tenues d’un devoir d’information et de recueil du consentement. En cas de manquement à ces obligations, elles pourront engager leur responsabilité civile et pourront être condamnées au paiement de dommages et intérêts.
Lorsqu’elles agissent de leur propre chef, elles pourront engager leur responsabilité civile pour ce même défaut d’information et de recueil du consentement. Mais elles pourront également mettre en jeu leur responsabilité civile, pénale et disciplinaire si elles ignorent les données acquises de la science et s’éloignent des règles de bonne pratique.
On comprend donc aisément que la responsabilité augmente avec le degré d’autonomie dont fait preuve la sage-femme dans le cadre du déclenchement de convenance.
En tout état de cause, il nous appartient de nous former régulièrement, par la lecture d’articles scientifiques, en assistant à des sessions de formation continue et en nous tenant informées des recommandations les plus récentes des autorités sanitaires. Cette nécessité nous permet de travailler dans les règles de l’art, en limitant les risques d’engagement de notre responsabilité et en offrant à nos patientes et à leur nouveau-né le plus haut degré de qualité de soins.
Bibliographie
- Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, Tita ATN, Silver RM, Mallett G et al. Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women. N Engl J Med. 2018 Aug 9;379(6):513-523
- CNRTL.fr [Internet] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales ; 2012. [Cité 2022 fév. 22] Disponible sur : https://www.cnrtl.fr/definition/responsabilit%C3%A9
- A. 12 octobre 2011, fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires, NOR : ETSH1127808A
- CSP, art. L. 1111-2, art L. 1111-4 et R. 4127-327
- Haute Autorité de Santé. Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé. Recommandations de bonne pratique ; 2012, Mai. 18 p.
- Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591
- CSP, art. L. 1110-5, art. R. 4217-325 et R. 4217-314
- Cass. crim. 18 mai 2010, n°09-83.032
- CE. 19 oct. 2001, n° 210590
- CA Versailles, 26 jan. 2017, n° 14/09204
- Haute Autorité de Santé. Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d’aménorrhée. Recommandations de bonne pratique ; 2011, Déc.