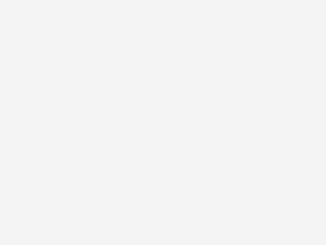Les réflexions sur la mort sont omniprésentes dans la philosophie occidentale. Est-ce parce qu’elle est majoritairement pensée par des hommes qu’elle s’intéresse si peu à la naissance ?

C’est indéniable ! Les hommes ont dominé l’histoire de la philosophie, et la pensée est liée au corps de celui qui la produit. Au-delà de ça, comme la naissance est derrière nous, les philosophes se sont plus intéressés à ce qui est à venir, à la question de la mort et de comment s’y préparer, comme un but à notre expérience de vie.
L’un de mes premiers postes était directeur référent du pôle gynécologie-obstétrique-néonatalogie à la Maternité de la Croix-Rousse (HCL, Lyon). J’ai aussi travaillé à
l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP, Paris). De fil en aiguille, ce sujet de la naissance m’est apparu comme une évidence !
Vous citez Hannah Arendt, une femme qui a placé la naissance au cœur de sa philosophie, mais n’a pourtant pas eu d’enfant, c’est paradoxal.
C’est en effet la première philosophe femme à avoir opéré une rupture dans la pensée occidentale. C’est le symbole qui l’intéresse. N’oublions pas qu’elle écrit à une époque particulière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Elle garde pourtant un formidable optimisme autour de l’idée de la naissance. Aujourd’hui encore, ce sont essentiellement des femmes philosophes, comme Cynthia Fleury ou Corine Pelluchon qui abordent la naissance dans leurs réflexions.
L’un des tous premiers philosophes, Socrate, avait pour mère une sage-femme. Coïncidence ou pas ?
Ce rapprochement entre la pratique des sages-femmes et celle des philosophes est fondamental pour moi. D’un point de vue symbolique, Socrate a rapproché l’idée du bébé à naître et celle du savoir. Le savoir est contenu en nous et quelqu’un doit le faire venir au monde. Faire accoucher une âme, c’est comme faire accoucher un corps, il y a la préparation en amont, il y a la difficulté de la délivrance de la vérité, et tous les soins qu’il faut apporter par la suite. Pour moi, la naissance est le fondement de la philosophie occidentale !
D’ailleurs, l’autre nom de la démarche philosophique est la maïeutique.
Vous parlez beaucoup de liberté. Pourtant on ne choisit pas de naître. Que nous reste-t-il alors comme liberté autour de la naissance ?
On a développé une aversion pour le risque qui fait que tout, autour de la naissance, est orienté vers le contrôle et la prévision. Et puis à la naissance, il y a tout l’héritage biologique, social, culturel qui semble prédestiner l’enfant à une vie déjà toute tracée. Or ce qui m’intéresse, c’est justement l’idée de l’indétermination totale. La naissance est le point de départ de toutes les possibilités, c’est le symbole de la liberté absolue. Il est urgent d’entendre cela : nous demeurons libres de choisir ce que nous voulons vraiment faire et responsables de qui nous voulons être.
Si chacun d’entre nous connaissait mieux le récit de sa naissance, cet événement serait-il plus facile à appréhender dans notre histoire personnelle ?
Vous avez raison, on raconte très peu la naissance, la célébration ou le bouleversement que cela a pu être. Alors que, comme le rappelle Hannah Arendt, il y a une naissance que nous connaissons tous, celle du Christ, et son récit est central dans la culture occidentale ! Dans une époque où l’on se tourne beaucoup vers soi-même, c’est surprenant que le récit de notre naissance soit si peu présent. Peut-être en effet que s’il l’était plus, cela libérerait une bonne part du mystère autour de cet événement, et libérerait ainsi l’individu.
Le courant « no child » prend de l’ampleur pour des raisons politiques et écologiques, qu’en pensez-vous ?
C’est une question plus d’ordre social que philosophique, mais elle m’intéresse beaucoup. Ce que j’ai voulu montrer en tant que philosophe, c’est en quoi faire des enfants participe finalement à la permanence de la vie humaine. Et qu’il faut se raccrocher à l’idée que mettre au monde un enfant, c’est aussi faire naître l’espoir que les choses peuvent changer par lui.
La maîtrise de la reproduction par les femmes est un pouvoir formidable. Est-ce pour cela qu’il est régulièrement remis en cause ?
La naissance a des enjeux qui dépassent l’individu et la famille. Ils sont notamment d’ordre démographique, économique et donc politique. Que les femmes soient en mesure de décider de ne pas avoir d’enfants peut être une menace pour certaines sociétés. Finalement le slogan « un enfant si je veux, quand je veux » est assez libertaire, c’est donc prévisible que des pans entiers du pouvoir réagissent et veuillent légiférer.
Nous devons être très vigilants là-dessus, car rien n’est acquis définitivement en termes de droits.
Vous parlez finalement assez peu de celles et ceux qui accompagnent ces naissances. Les sages-femmes n’ont-elles pas un rôle à jouer dans cette philosophie de la naissance ?
Quand j’écris, j’essaye de ne pas trop aborder des questions qui m’occupent professionnellement. Mais j’ai beaucoup de respect pour la profession de sage-femme. Aujourd’hui les femmes veulent de plus en plus s’approprier leur grossesse et leur accouchement. On le voit par exemple à travers le développement des maisons de naissance et de l’accouchement à domicile. En même temps, les écoles de sages-femmes ne font plus le plein, et celles qui sont formées se détournent des maternités publiques. C’est un problème qui prend de l’ampleur et sur lequel nous devons nous interroger. Il y a une profonde recomposition du paysage de la naissance et il faut accompagner les sages-femmes dans ces mutations.
Êtes-vous inquiet face à cette évolution ?
Ce qui m’inquiète beaucoup c’est que l’on puisse dire aujourd’hui à une femme « vous allez devoir accoucher ailleurs, car nous n’avons pas assez de sages-femmes à la maternité », c’est terrible. Cet été, on a beaucoup parlé du problème des Urgences, alors qu’en même temps il y a eu des fermetures temporaires de maternités et des femmes ont dû être réorientées, et malheureusement on en a peu parlé, alors qu’il y a un vrai problème de fond sur l’organisation des soins sur tout le territoire.
Dans vos remerciements vous évoquez un hommage socratique aux sages-femmes, de quoi s’agit-il ?
Je veux rappeler aux sages-femmes qu’à travers la mère de Socrate qui faisait le même métier qu’elles, elles ont quasiment donné naissance à la philosophie occidentale. Et ça n’est pas rien ! Cette dédicace est un exercice de réminiscence. Elles ne doivent pas oublier qu’elles font un métier fondamental, depuis longtemps et pour toujours.
■ Propos recueillis par Émilie Gillet